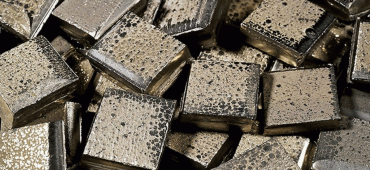Responsable de la Practice Énergie et Environnement chez Wavestone
L’Union européenne a fait de la sécurisation de son approvisionnement en matières premières critiques une priorité stratégique. Face à la dépendance croissante envers des fournisseurs étrangers, notamment la Chine, l’Europe a décidé de prendre les devants en soutenant des initiatives visant à renforcer son autonomie industrielle. La labellisation de 47 projets stratégiques ces derniers jours dans le cadre du Critical Raw Materials Act (CRMA)(1) représente une avancée notable.
Mais alors que ces projets marquent une étape importante, des questions subsistent : comment transformer ces initiatives en réalité opérationnelle ? Quels défis restent à surmonter ? Et surtout, cette stratégie permettra-t-elle vraiment d’assurer la souveraineté de l'Europe en matière de ressources critiques ?
Un enjeu crucial pour l’autonomie stratégique de l’UE
Les matières premières critiques(2) et les métaux rares sont indispensables à de nombreux secteurs stratégiques, de la transition énergétique à la fabrication de batteries, en passant par l'industrie aéronautique et la microélectronique. Or, l'Europe dépend à plus de 80% des importations pour nombre de ces ressources (à titre d’illustration, parmi les matières premières critiques transformées, la dépendance est de 75% pour le nickel et presque 100% pour le lithium et les terres rares).
Face à cette vulnérabilité, l'UE a identifié trois axes d’action majeurs :
- le premier vise à diversifier les sources d'approvisionnement en développant de nouveaux partenariats internationaux pour limiter la dépendance à quelques acteurs dominants ;
- le deuxième repose sur le renforcement des capacités d'extraction et de raffinage sur le territoire européen afin de réduire la dépendance extérieure ;
- le troisième axe consiste à développer une économie circulaire qui mise sur le recyclage et la réutilisation des matériaux existants pour diminuer la pression sur l'extraction.
Au moment de dévoiler la liste des projets labellisés, le vice-président de la Commission européenne, en charge de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné, a indiqué que « l’Europe dépend actuellement de pays tiers pour de nombreuses matières premières dont elle a particulièrement besoin. Nous devons augmenter notre propre production, diversifier nos approvisionnements externes et constituer des stocks ».
47 projets labellisés dans 13 pays, dont 9 en France, un marqueur fort de la dynamique européenne
Les 47 projets stratégiques qui viennent d’être labellisés(3) sont répartis dans 13 pays européens. La France est le pays qui en compte le plus, avec neuf initiatives soutenues, suivie de la Suède avec sept projets et de la Finlande avec six. L'Allemagne en compte cinq, tandis que l'Espagne et l'Italie en développent chacune quatre. Le Portugal et la Pologne affichent trois projets chacun, l'Estonie en recense deux et enfin la Tchéquie, la Grèce, la Belgique et la Roumanie comptent chacun un projet labellisé.
Ces initiatives couvrent différentes étapes de la chaîne de valeur des matières premières. Sur les 47 projets labellisés, 25 concernent l’extraction de nouvelles ressources en Europe. Vingt-quatre projets se concentrent sur la transformation des matières premières pour développer des capacités industrielles locales. Dix projets visent à améliorer le recyclage des matériaux critiques afin de réduire la dépendance à l’extraction minière. Enfin, deux projets se consacrent à la recherche de solutions de substitution aux matières premières stratégiques afin d’en limiter l’utilisation.
Les 25 projets d'extraction concernent de nouvelles mines de lithium, de graphite, de tungstène, de cuivre, de cobalt ou de nickel. Deux se situent en France : en Auvergne (projet d’extraction de lithium) et en Alsace (récupération de lithium dans les eaux géothermales). Les autres projets miniers se trouvent dans le nord de la Suède ou de la Finlande, en Espagne, en Roumanie et en République tchèque.
Les projets comptent aussi un grand nombre d’usines de raffinage et de recyclage. La France pourrait en accueillir sept comme celle de Lacq, destinée au recyclage de terres rares pour produire des aimants ou celle de Sandouville, près de Rouen, pour recycler du nickel, du cobalt et du manganèse.
Une labellisation européenne, synonyme de soutien public et d’accélération des démarches administratives
Les projets sélectionnés recevront 22,5 milliards d'euros au total, ainsi que le label de la Commission européenne. Et pour démarrer au plus vite, ils bénéficieront également de procédures accélérées.
L'octroi « de permis ne dépassera pas 27 mois pour les projets d'extraction et 15 mois pour les autres projets. À l'heure actuelle, les processus d'autorisation peuvent durer de cinq à dix ans », précise l'exécutif européen.

Source : Commission européenne. Les régions d'implantation des projets labellisés sont indiquées ci-dessus(4).
Des défis persistent quant à la mise en œuvre de la politique européenne
Malgré ces annonces ambitieuses, plusieurs défis de taille subsistent. Au premier rang desquelles, des contraintes administratives et environnementales. L’ouverture de nouvelles mines et d’unités de raffinage en Europe se heurte à des réglementations strictes et à une opposition locale. L’exploitation minière, bien que nécessaire, est souvent perçue comme une menace pour l’environnement et les communautés locales. Les normes environnementales européennes étant parmi les plus strictes au monde, l’obtention des autorisations peut prendre plusieurs années, voire être bloquée par des recours juridiques ou des mouvements citoyens. Assouplir la réglementation sans compromettre la protection environnementale sera un défi majeur pour accélérer la mise en œuvre de ces projets.
L'Europe doit également faire face à une concurrence mondiale féroce. La Chine contrôle aujourd’hui près de 60% du raffinage des terres rares et exerce un quasi-monopole sur certaines matières stratégiques. Les États-Unis et le Canada investissent massivement dans leurs propres chaînes d’approvisionnement et tentent de sécuriser leurs ressources en signant des accords bilatéraux avec des pays producteurs. Face à ces acteurs puissants, l’Europe doit se doter d’une stratégie plus offensive et veiller à ne pas être marginalisée dans la course aux matières premières.
De plus, si l’Union européenne apporte un soutien via des programmes comme l'IPCEI (Projet Important d'Intérêt Européen Commun), les investissements privés restent difficiles à mobiliser. Les marchés des matières premières étant soumis à d'importantes fluctuations de prix, les investisseurs hésitent à s'engager sur le long terme. L’Europe devra donc renforcer ses incitations financières en créant des garanties et en soutenant activement les projets à travers des mécanismes de subventions et des prêts attractifs.
Un réel espoir pour la souveraineté européenne ?
Malgré ces obstacles, les projets labellisés offrent une opportunité unique de renforcer l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des grandes puissances minières. En mettant en place un cadre réglementaire plus favorable, en investissant dans la recherche et le développement et en développant des partenariats stratégiques avec des pays fournisseurs fiables, l'UE peut réduire progressivement sa dépendance et gagner en souveraineté.
D'ici 2030, si ces initiatives aboutissent, l'Europe pourrait couvrir une part significative de ses besoins en matières premières critiques, notamment pour le lithium et le cobalt, essentiels aux batteries des véhicules électriques. Le recyclage jouera également un rôle majeur en permettant de limiter la pression sur l'extraction et en optimisant les ressources disponibles. En parallèle, des progrès dans la substitution de certains matériaux pourraient réduire la dépendance à certaines ressources rares, diminuant ainsi la vulnérabilité des industries européennes.
Une ambition qui reste à concrétiser
La labellisation des 47 projets stratégiques est une avancée importante, mais elle ne représente qu’une première étape. L'Europe doit maintenant transformer ces initiatives en réalisations concrètes en surmontant les obstacles réglementaires, financiers et technologiques. Sans une mise en œuvre rapide et efficace, le risque est grand de voir l’UE rester dépendante des puissances extérieures et vulnérable face aux chocs géopolitiques.
Le défi de la souveraineté des matières premières est loin d'être gagné, mais l'Europe a les cartes en main. Reste à jouer la partie avec détermination et cohérence.
Sources / Notes
- Critical Raw Materials Act, Commission européenne.
- Depuis 2011, une liste de matières premières critiques pour l'économie européenne est mise à jour tous les trois ans par la Commission européenne. Les principaux indicateurs utilisés pour cette mise à jour sont l'importance économique et le risque d'approvisionnement. Le nombre de matières premières identifiées comme critiques est passée de 14 en 2011 à 30 en 2020, dont le cobalt, le lithium, le phosphore ou encore le titane.
- Commission selects 47 Strategic Projects to secure and diversify access to raw materials in the EU, Commission européenne, 25 mars 2025.
- Carte plus détaillée des projets labellisés sur le site de la Commission européenne.